Services
An. 1 Simp. Internacional do Adolescente May. 2005
Féminin mélancolique
Catherine Chabert
Certaines histoires de filles ressemblent à des tragédies sacrificielles: pourtant, dans un premier temps, le défaut libidinal s'y annonce patent dans les insuffisances de la dramatisation et l'apparente absence de scénarios susceptibles de contenir les fantasmes originaires, autant d'écrans ou de masques qui préservent d'une sexualité persécutante. Je voudrais en effet m'attacher au destin sacrificiel du corps, considéré comme source du mal, dans un processus qui s'apparente à la mélancolie, destin qui me paraît régulièrement actualisé dans les traitements analytiques d'adolescentes présentant des comportements d'auto-sabotage. Je proposerai à cet effet deux études de cas: celui d'une jeune fille boulimique, celui d'une autre jeune fille présentant une trichotillomanie sévère.
Cet écueil pulsionnel me paraît lié – et je souhaite argumenter ce point de vue – à la singularité de constructions des fantasmes originaires, et plus particulièrement des fantasmes de séduction. Singularité repérable dans une version qui se détourne de sa forme hystérique, engage le masochisme moral'et bascule dans un mouvement mélancolique.
*
Il'est vrai que Thérèse ne m'a pas fait d'emblée penser à une héroïne de tragédie, mais justement à son inverse extrême. Sa présentation de Bécassine, maladroite et touchante, empêtrée dans son obésité et sa détresse (elle vient me voir pour la première fois en hiver, les pieds nus dans ses grosses chaussures) me laisse rapidement perplexe. Je veux dire dès qu'elle se met à parler: le débit rapide, le flot verbal ne laissent passer cette fois aucune maladresse ni lourdeur de langage. Son propos est ordonné par une grammaire parfaite, associant à la rigueur syntaxique une richesse de vocabulaire exceptionnelle et foisonnante. Je garde ainsi de notre première rencontre, le souvenir étrange d'une double image, presque discordante, où deux portraits de femmes se déploient en parallèle, sans véritable point d'ancrage: le discours séduit, prolixe, aisé, fluide ; hors du corps, coupé de cette masse informe, enveloppée de noir, affaissée sur le fauteuil; une figure du désespoir, un beau visage torturé, déformé par l'angoisse et cette parole facile pour la dire dans son intensité et dans sa force taraudante. Angoisse qui conduit Thérèse à des crises de boulimie effrayantes, compulsives, envahissantes, seul recours, seul secours pour elle pour accéder au calme. Thérèse passe l'essentiel de son temps à se remplir, engloutissant des quantités inimaginables de nourriture, vautrée sur son lit, passive devant le défilé de cassettes-vidéo qu'elle consomme avec avidité. Les "crises" la laissent pétrifiée de honte, dévorée par le sentiment de vivre comme un "sous-être", indigne de se montrer, indigne d'être regardée, indigne d'être aimée. Elle est emportée par une mortification itérative, justifiée par son égoïsme, son repli relationnel'et l'auto-suffisance qui régissent ses crises ; alors que son idéal lui impose les valeurs contraires d'altruisme, d'ouverture, de communication et de dévouement.
Cet idéal, érigé en principe universel, est soutenu par les figures parentales : Thérèse déclare qu'elle a été élevée avant tout dans le but de satisfaire cet idéal, à la fois sur le plan physique et intellectuel.
Physiquement, il fallait se plier aux exigences de sa mère, oublier le corps, ses besoins, son confort, ses plaisirs : ignorer ses attentes, négliger ses douleurs. Bien plus tard, Thérèse parle de la distance entre sa mère et elle, de l'absence de caresses et du froid et de la tristesse qui l'étreignent en hiver, comme si elle n'était jamais assez couverte, jamais emmitouflée, jamais vraiment protégée.
Intellectuellement, il fallait se plier au modèle de son père, travailleur acharné, brillant, cultivé, attaché à des principes ascétiques, érigeant en valeur suprême le contrôle de soi, l'abnégation et… la distance. Plus tard, aussi, Thérèse rappelle la petite fille parfaite qu'elle a su être, la fierté de son père et son idée, à elle, qu'elle ressemblait à la sainte dont elle portait le nom et qu'elle embrasserait la vie au couvent pour le plaisir et l'amour de son père.
Ainsi Thérèse est prise dans le carcan idéalisant qu'elle s'est construit à partir de deux systèmes complémentaires et congruents, celui de la mère, celui du père – donnant prise, en quelque sorte, à une problématique éminemment narcissique dans laquelle va s'engouffrer un masochisme moral dévastateur.
L'enfance est facile, une vie "claire et limpide" dit Thérèse, petite fille maigre et sage, élève brillante, enfant douée pour tout : les études, la musique, le théâtre, la littérature et le cinéma.
La puberté vient effracter ce pseudo paradis, dans le bouleversement des premiers émois sexuels qui font fuir Thérèse dans un mouvement de panique inextinguible, préliminaire au déclenchement des crises de boulimie. Elle est brutalement confrontée à l'existence en elle de sensations corporelles qu'elle condamne immédiatement. Sa culpabilité est attisée par la trop grande proximité d'une fantasmatique œdipienne au sein de laquelle l'inceste, insuffisamment refoulé, fait retour dans des scènes masochistes où elle se fait brutaliser par son père. Ainsi s'organise la conviction d'avoir séduit activement le père, en déclenchant chez lui une violence inattendue, débordante et sidérante. Ainsi se détermine l'absolue nécessité d'anéantir toute manifestation, tout signe de féminité susceptible d'exciter l'autre. Mais cette attaque n'est pas suffisante : dans le même mouvement qui abîme son corps, Thérèse s'acharne contre son intelligence et ses réussites. Elle abandonne ses études, réprime sa curiosité, elle veut, dit-elle, être seulement grosse et bête, donc elle "boulimique" et boulimique sans fin.
L'hypersexualisation n'a pas trouvé de déplacements suffisants pour contenir l'excitation psychique qu'elle engendre ; seules les boulimies permettent son abrasion par la frénésie qu'elles appellent et par l'état d'anesthésie qu’apportent l'isolement, l'apragmatisme et la léthargie qui leur sont associés.
Bien sûr, nous sommes confrontés l'encore à un recours en actes qui tente d'obérer les fantasmes en offrant une voie de décharge à une excitation éprouvée comme insoutenable. Mais à vrai dire, il n'y a pas de compromis possible dans la mesure où cette activité compulsive, qui prend parfois l'allure de rituels pseudo-obsessionnels, nourrit elle-même une culpabilité dévastatrice et s'emballe progressivement. L’ingurgitation massive de nourriture vient alors mortifier ce corps qui prétend se constituer comme source de désirs inavouables, corps régulièrement violenté et malmené : répétition mortifère et humiliante dont on peut souligner la visée "désobjectalisante" au sens où l'entend A. Green (1984), comme visée de la pulsion de mort attaquant non seulement la relation à l'objet "mais aussi tous les substituts de celui-ci, le moi par exemple et le fait même de l'investissement en tant qu'il'a subi le processus d'objectalisation".
C'est le corps qui est ici "désobjectalisé" dans le refus de le voir se constituer comme source du désir de l'autre. C'est le corps qui devient lieu de désaveu des fantasmes originaires. Si Thérèse va mal, c'est certes pour "sauver" sa mère, si elle s'efforce de flétrir l'image de son corps à l'instar de celui qu'elle prête à sa mère vieillissante, si elle exclut ses désirs pour dénier ceux de sa mère, c'est bien que l'enjeu primordial'est là, dans le refus de reconnaissance de la sexualité parentale, dans la lutte contre l'émergence de fantasmes de scène primitive.
Processus banal, dans une certaine mesure, et notamment à l'adolescence, mais qui l'est moins ici, car il se double d'un autre mouvement, plus archaïque, associé à la violence maternelle, mais non reconnu comme tel, déplacé en quelque sorte sur le père. Chez Thérèse, devenue au cours de l'enfance le contenant puis la dépositaire de cette violence et de cette excitation, le retournement de la haine contre elle-même entraîne une culpabilité dont les accents mélancoliques sont parfois alarmants : la disparition manifeste de l'agressivité maternelle, au profit si j’ose dire de sa dépression, la prive en effet des bénéfices masochistes qui la rendaient supportable.
J'en viens maintenant à l'essentiel de mon propos : la place et la fonction du sacrifice au sein de ces organisations fantasmatiques singulières qui semblent renverser la construction hystérique de la séduction et la font basculer dans une dérive mélancolique par la participation grandissante des mouvements d'auto-accusation presque délirants qui l'animent.
Si l'on se réfère aux particularités de la construction hystérique des fantasmes de séduction, on doit retenir l'importance de la mise en jeu active de la séduction suscitée dans l'autre, afin de mettre à jour son désir dans un retournement révélateur. "Ce n'est pas moi qui le séduis, c'est l'autre qui me désire" : l'autre est ainsi clairement désigné comme agent séducteur au sein d'une scène excitante, certes, mais qui préserve l'auteur du fantasme, dans son innocence et dans l'ignorance – apparente – de ses propres mouvements de désirs. Piège dans lequel Freud s'est d'abord laissé prendre : si Emma est prise de panique lorsqu'elle rencontre les deux hommes qui rient dans la boutique où elle vient d'entrer, elle peut immédiatement penser qu'ils "s'étaient moqués de sa toilette et que l'un d'eux avait exercé sur elle une attraction sexelle". Le souvenir ancien, à 8 ans, dénonce tout autant le séducteur : "... le marchand avait porté la main, à travers l'étoffe de sa robe, sur ses organes génitaux."(1895, p 364).
Que Freud renonce, dès 1897, à la réalité du traumatisme sexuel n'est pas essentiel ici, car la fantaisie qui vient en prendre la place, positionne tout autant l'autre (l'adulte) actif face à un sujet (enfant) passif : l'écart est maintenu entre l'autre "pervers" et l'enfant innocent. Cette "innocence" est sérieusement mise à l'épreuve à l'adolescence, car les émois sexuels s'imposent avec une si grande force qu'ils nécessitent une surenchère des fantasmes de séduction: la participation active du sujet risque de devenir de plus en plus évidente, trahissant éventuellement une provocation séductrice qui, cette fois, vient du dedans, ce qui entraîne bien sûr une culpabilité intense. Le renforcement du scénario hystérique soutient l'identification passive et le refoulement de la fantasmatique incestueuse.
Chez Thérèse, comme chez celles qui lui ressemblent, on ne repère pas une dénonciation possible de l'attentat séducteur et excitant chez l'autre, grâce à un mouvement de projection protecteur, mais au contraire la nécessité de le fixer de leur côté à elles. Elles ne sont plus victimes mais criminelles : c'est leur corps et l'excitation dont il'est porteur qui deviennent persécuteurs et doivent par là-même être détruits par l'extinction des mouvements pulsionnels : il y a non seulement une attaque désobjectalisante, comme le signale A. Green, mais une mise à mal des investissements libidinaux, une délibidinisation à la fois objectale et narcissique. Les désirs sont ressentis comme des forces mauvaises, impures et donc soumis à une rétorsion drastique, traduite notamment par l'ampleur de la disqualification et la mésestime de soi qui imposent des conduites sacrificielles visant justement le corps dans sa capacité à séduire et à en éprouver du plaisir. C'est l'autre versant de la séduction qui prend le pas, non plus le désir de plaire et de charmer mais plutôt la tendance à corrompre, renforçant encore le poids de la déréliction : c'est ce destin là qui risque de s'enliser dans la mortification d'une sexualité expiatoire.
Ainsi, à l'inverse de ce qui se passe dans l’hystérie, Thérèse cherche avidement l'état de déréliction, de détresse psychique, sans être pour autant capable de reconnaître et de montrer ses attentes, son besoin d'aide : elle s'efforce activement, non pas de faire naître le désir de l'autre ou même de provoquer une réponse, mais tout au contraire, de le désavouer afin de ne pas se penser comme son objet. Elle se situe, là, en deçà de défenses narcissiques qui s'efforceraient de nier la source interne de la pulsion pour lutter contre la dépendance impliquée par tout mouvement de désir susceptible d'être satisfait par l'autre. En deçà, car elle ne parvient pas à colmater les brèches profondes d'atteintes narcissiques fondamentales, écho désespéré d'une impossible attaque de l'objet. La violence destructrice est massivement retournée contre un moi menacé de délabrement : le triomphe sacrificiel ne lui apporte de bénéfices que transitoires et précaires, parce qu'il se sert de conduites symptomatiques qui s'automatisent progressivement et s'emballent dans des actes itératifs dépersonnalisants : les satisfactions auto-érotiques initiales, fortement engagées par le fantasme masochiste inaugural, s’éteignent progressivement, par l'usure répétitive et l'appauvrissement de l'activité imaginaire. Si au départ, l'état quasi orgastique déterminé par la crise de boulimie était soutenu par une fantasmatique condensant la source du plaisir et sa sanction, si donc c'est à partir d'un scénario douloureux certes, mais doté de sens que s'engage la compulsion, le fantasme s’étiole inéluctablement, dans la mesure où la satisfaction libidinale en est proscrite.
Ainsi chez Thérèse, toute forme d'investissement libidinal'est abolie et, dans le même temps où elle prive son corps de tous ses plaisirs, elle interdit à sa pensée de se déployer, voire même de s'exercer.
Seule subsiste la douleur et l'attachement qui la lie aux objets d'amour originaires. Une douleur qui constitue alors un contre-investissement des mouvements pulsionnels dans leurs visées objectales, contre-investissement des mouvements d'amour et de haine pour les objets originaires. Le renoncement impossible à ces objets, dans leur prise incestueuse notamment, contraint le maintien de la douleur, seule trace acceptable, porteuse de ces liens. Il s'agit là de formes extrêmes du masochisme moral tel que Freud l'élabore en 1924 : la relation du masochisme moral'avec la sexualité se trouve relâchée ; alors que dans les autres cas (masochisme érogène, masochisme féminin), les souffrances masochistes impliquent la personne aimée, cette condition n'est pas remplie dans le masochisme moral, car c'est la souffrance elle-même qui importe. On n'est pas loin, dit Freud, de laisser de côté la libido et de rabattre le masochisme moral sur la pulsion de mort retournée contre le soi propre : "mais pourtant le fait que l'usage de la langue n'a pas abandonné la relation à l'érotisme de cette norme de comportement dans la vie, et qu'il nomme masochistes également ceux qui ainsi se font dommage à eux-mêmes, cela devrait avoir un sens"1 (1924, p 17).
Plus loin, dans le même texte, Freud s'interroge sur les points communs et les différences entre conscience morale et masochisme moral. Dans le premier cas, l'accent porte sur le sadisme du surmoi qui devient le plus souvent crûment conscient. À l'inverse, les désirs masochistes restent inconscients, dans le cas du masochisme moral, et se traduisent uniquement à travers le comportement.
Par ailleurs, et c'est ce passage là qui importe particulièrement pour mon propos : "nous savons que le souhait, si fréquent dans les fantasmes, d'être battu par le père, se trouve tout près de l'autre, celui d'entrer dans une relation sexuelle passive (féminine) avec lui [; …] si nous insérons cet éclaircissement dans le contenu du masochisme moral, son sens secret nous devient évident. Conscience morale et morale sont nées du surmontement, de la désexualisation du complexe d’Œdipe ; par le masochisme moral, la morale est de nouveau sexualisée, le complexe d’Œdipe est revivifié, une voie de la morale au complexe d’Œdipe est frayée [; …] le masochisme crée la tentation des actions "pêcheresses" qui doivent ensuite être nécessairement expiées par les reproches de la conscience morale sadique [; …] ou par le châtiment de la grande puissance parentale du destin. Pour provoquer la punition par cette dernière représentance parentale, le masochiste doit nécessairement faire ce qui est inapproprié, travailler contre son propre avantage, détruire les perspectives qui s'ouvrent à lui dans le monde réel'et éventuellement anéantir sa propre existence réelle "(ibid, p 22).
Si je cite presqu’in extenso ce passage, c'est qu'il me semble s'appliquer avec une précision et une acuité particulièrement pertinentes au processus morbide agissant chez les femmes boulimiques.
Voici la construction que je propose : dans les troubles graves des conduites alimentaires (ou d'autres pathologies symptomatiques qui trouvent leurs voies d'expression dans le comportement) qui touchent préférentiellement les filles et les femmes, le masochisme moral s'ancre, dans la resexualisation œdipienne, à une fantasmatique incestueuse prégnante, déterminant une angoisse majeure de perte d'amour et un retournement haineux, contre soi, des attaques destructrices de l'objet. C'est l'impossible mise en scène de la rivalité avec la mère, certes, mais aussi l'impossible confrontation à la passivité qui engage la version mélancolique des fantasmes de séduction : la fille, coupable de séduire le père, devient la cible privilégiée des accusations de transgression et du châtiment auquel'elles exposent – châtiment que l'accusée se charge d'assurer elle-même : au-delà de l'expiation mortifiante à laquelle elle se soumet, c'est la mère qui est visée, et atteinte du fait de la prévalence des identifications narcissiques.
Venons-en maintenant au dernier point de la construction que je propose, c'est-à-dire au passage du masochisme moral à une forme de mélancolie. Je dis bien une forme car, comme Freud le souligne dès l'introduction de Deuil'et mélancolie, les formes cliniques de la mélancolie sont très diverses si bien que la définition conceptuelle en devient fluctuante.
La description symptomatique de la mélancolie, en 1915, annonce étonnamment celle du masochisme moral, en 1924. L'humeur douloureuse, l'absence d'intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d'aimer, l'inhibition, autant d'éléments caractéristiques d'un mode d'être qui "travaille" contre le moi ; mais surtout – je cite – "l'abaissement du sentiment de soi qui se manifeste en auto-reproches et auto-injures"(1915, p 264) offre un discours qui met en mots les mouvements profonds d'auto-punition impliqués dans le masochisme.
Cette clinique ressemble à s'y méprendre à celle que j'ai rencontrée chez Thérèse, à cette différence près que la jeune femme a remplacé par les excès boulimiques, la perte d'appétit habituellement trouvée par Freud.
Cependant, au-delà de la clinique, c'est la reconstitution du processus qui peut nous intéresser, pour l'élaboration métapsychologique qui s'en dégage : à l'origine de ce processus, une intense déception dans la relation à un objet d'amour particulièrement investi (et donc, pourquoi pas, une intense déception œdipienne actualisée à l'adolescence). À partir de là, le mouvement qui comprendrait le retrait de libido attachée à l'objet décevant et son déplacement sur un nouvel objet, ce mouvement "normal" ne se déclenche pas dans le sens attendu, mais prend un autre cours : l'investissement d'objet, peu résistant, est ramené dans le moi et participe à la mise en place de l'identification du moi avec l'objet abandonné. Si bien que c'est le moi qui est jugé (du fait de l'ombre de l'objet délaissé tombée sur lui) et la perte d'objet se transforme en perte du moi.
Cependant, au commencement, le choix d'objet a dû nécessairement se fonder sur une base narcissique (sinon l'investissement d'objet aurait été davantage résistant) : si des difficultés apparaissent dans la relation à l'objet (par exemple la déception), la régression narcissique est inéluctable et "l'identification narcissique avec l'objet devient alors le substitut de l'investissement d'amour"(ibid p 271). Ce mécanisme, caractéristique des affections narcissiques, permet l'abandon de l'objet et le maintien de l'amour pour l'objet, réfugié dans l'identification narcissique.
Grâce à la condensation qui associe le crime et l'expiation, l'abandon de l'objet et la permanence de l'amour, la problématique du féminin, dans la boulimie, décline son masochisme dans une tonalité mélancolique. La haine contre l'objet s'exerce contre son substitut – le sujet lui-même – en l'injuriant, en le rabaissant, en le faisant souffrir et en tirant de cette souffrance le bénéfice d'une satisfaction sadique. C'est dire qu’être criminelle ne suffit pas, il faut aussi devenir son propre bourreau. Nécessité imposée par l'adresse de la haine : l'auto-punition (c'est Freud qui le souligne) permet l'accomplissement de la vengeance sur les objets originaires et l'état de maladie s'offre au sujet comme intermédiaire pour tourmenter ceux qui lui sont le plus chers.
Au détour de la mélancolie, se retrouvent donc les effets parfois tragiques du masochisme moral dans les processus de déliaison qui lui sont attachés, ce qui rend compte de l'envahissement par la compulsion de répétition et du repli autarcique imposé par les conduites symptomatiques.
L'absence de construction de fantasmes de séduction sur un mode hystérique me paraît constituer l'un des indices les plus manifestes de ce travail de déliaison. Cette absence signale les tentatives de désobjectalisation des mouvements pulsionnels, avec les risques d'enfermement pervers ou mélancolique qu’une telle stratégie défensive peut faire craindre.
Il y a donc nécessité, en de telles situations, de saisir les traces libidinales subsistantes, il y a urgence, au sein du processus thérapeutique, à mobiliser les mouvements de vie à la fois dans le sens d'une reconstruction narcissique minimale et d'un étayage de la vie fantasmatique. Moins du côté du travail de figuration des représentations, souvent déjà présent et effectif, que dans la prise de contact avec les affects et leur soutien. Je veux dire que la tâche essentielle, dans les commencements de l'analyse, relève de la liaison des affects et des représentations de perte d'objet, affects généralement déniés ou abrasés, comme si dans le même mouvement, la tentative de désexualisation avait emporté avec elle les alternances du désir, la dialectique de la présence et de l'absence, et les "éprouvés" – pour reprendre le terme de P. Aulagnier – qui leur étaient associés, qui ont été perdus et qui attendent d'être (re)trouvés.
*
Je souhaite maintenant présenter une seconde étude de cas qui nous permettra de poursuivre la réflexion déjà engagée à propos de Thérèse, au sujet notamment de la passivité à l'adolescence.
Elle est venue me voir pour le dixième anniversaire de l'arrivée de son symptôme. Dix ans, c'est aussi, me dit-elle d'emblée, l’âge de la mort de son frère aîné qu'elle n'a pas connu et à qui, croit-elle, elle doit sa naissance, car pourquoi, sinon, ses parents auraient-ils souhaité, si tard après les deux autres, un nouvel'enfant ?
Gloria a 20 ans, elle n'est plus une adolescente, mais elle n'est pas non plus une femme adulte. Elle demeure, psychiquement, arrêtée à ses dix ans comme si, en effet, une déchirure était venue couper le fil du temps, le fil de sa vie. C'est une grande et belle fille, elle ressemble à une madone de Bellini, une mater dolorosa qui pleure sans cesse, laissant couleur des larmes d'abondance, sans les exhiber, sans les cacher non plus. Ce qu'elle cache soigneusement, sous le foulard artistement noué qui concourt à accentuer encore la forme mélancolique de son visage, ce qu'elle cache, c'est son crâne dégarni, les plaques nues du cuir chevelu, les traces de sa honte et de son sacrifice : depuis dix ans, Gloria s'arrache régulièrement, méthodiquement, inéluctablement les cheveux.
À première vue, l'analogie, l'interprétation pourrait d'emblée s'imposer : elle s'arrache les cheveux comme les malheureuses, comme les pleureuses des morts, comme les veuves éplorées, comme les mères meurtries par la mort d'un enfant.
À première vue, la contrainte qui oblige Gloria à répéter sans fin ces actes compulsifs pourrait témoigner d'une mortification sans cesse réitérée pour un crime, lui aussi trop facilement repérable, trop facilement rejetable : de la mort de son frère, elle n'est, logiquement, raisonnablement, nullement coupable.
Mais ces signes perceptifs, le caractère visible de la symptomatologie ne peuvent en aucune manière être d'emblée saisis par une signification trop rapidement construite. Bien entendu, ce sens initial qui s'impose comme un contenu manifeste n'est pas faux, en lui-même. Entre la mort du frère et les cheveux arrachés, il y a un lien, c'est sûr. Mais le chemin qui va de l'un à l'autre ne se dessine pas clairement au sein d'une topographie linéaire. Il passe par le réseau compliqué des représentations et des affects, il se perd dans les fantasmes, et s'abîme dans l'enfance. Il n'y a pas de symptômes simples, nous le savons bien.
J'ai choisi aujourd'hui, pour parler des paradoxes de la passivité, de suivre le fil conducteur de la perception, parce que cette notion mérite d'être approfondie à partir des troubles fréquents qui, justement, au moment de l'adolescence, se présentent d'abord sous forme d'actes ou d'effets d'actes qui se donnent à voir. Je fais référence ici notamment aux conduites à risques, aux troubles des conduites alimentaires, en fait à l'ensemble des symptômes qui montrent essentiellement que l'adolescent se fait du mal, plus particulièrement dans un système où la compulsion en actes occupe une place majeure.
Dans la première topique freudienne – celle qui différencie conscient/préconscient/inconscient – les circuits s'engagent dans les deux directions : de la perception/conscience à l'inconscient, de l'inconscient vers le conscient, et le préconscient occupe une fonction essentielle de transformation des perceptions. Celles-ci, lorsqu'elles proviennent de l'inconscient, trouvent leur source à l'intérieur de la psyché et non plus dans les stimuli du monde extérieur.
La dialectique des perceptions externes et internes constitue un pivot majeur dans la mesure où elles s'alimentent mutuellement, interagissent les unes sur les autres. Cela signifie qu'elles sont susceptibles d'avoir un pouvoir de transformation et donc de déformation. En fait, ce que nous désignons comme "représentations" se constitue à partir de perceptions, les représentations sont susceptibles d'être considérées comme des perceptions transformées, modifiées, déformées, si l'on admet une double acception de ces dernières, en reconnaissant leur statut externe et interne. L'acte de perception intervient alors dans l'espace de contact entre dedans et dehors, bien sûr, mais aussi à l'intérieur, entre dedans et dedans, en quelque sorte. L'appel à des perceptions "externes", le recours à des images de la réalité matérielle, sont alors parfois utilisés pour donner forme, figure à des perceptions internes floues, massives ou mal différenciées.
Il nous faut souligner ainsi qu’on ne saurait considérer la perception comme une opération psychique séparée, isolée voire clivée par rapport au monde interne. Elle ne concerne pas seulement, peu s'en faut, les modalités de relations avec le dehors : elle est fondamentalement impliquée dans le rapport du sujet avec son monde intérieur et avec le monde externe. Les deux sont indissociables dans la mesure où, quelles qu'en soient les configurations, le sujet et le monde inscrivent leur existence dans leurs articulations à la fois essentielles et singulières.
Il y a dans "La négation" (1925) une insistance évidente sur cette double implication, sur cette double source interne/externe, à l'image du jugement et de la pensée. Rappelons brièvement que dans ce texte Freud se penche, dans son étude sur la genèse de la pensée, sur les liaisons entre perception et représentation. L'objectif de l'opération de jugement serait d'abord de distinguer ce qui revient au dedans d'une part, au dehors d'autre part : cette opération devrait signaler un repérage assez fiable des limites entre réalité interne et réalité externe, grâce à l'établissement d'indices significatifs : "On peut reconnaître comme condition pour la mise en place de l'expérience de réalité que des objets aient été perdus qui autrefois avaient apporté une satisfaction réelle" (tr. fr. p 170). On voit bien ainsi de quelle manière sont intrinsèquement tissés les liens entre le dehors – l'expérience de réalité – et le dedans – la satisfaction "réelle" – et en même temps l'ambiguïté de leur alliage, la prégnance de ce qui les "mêle", en créant un potentiel intermédiaire : l'expérience (de la réalité) relève évidemment de la subjectivité, d'une mise à l'épreuve, d'une mise en péril (périr) essentielle du sujet en tant que tel ; la satisfaction, qui elle aussi relève d'une "expérience", appelle de son côté, immanquablement, l'objet externe, "spécifique", qui, originairement, est susceptible d'apaiser l'excitation du besoin.
La question de l'affect – qu'il s'agisse du plaisir lié à la satisfaction ou du déplaisir déterminé par son absence – est, au départ, comprise dans celle de la perception : la qualité d'affect est aussi presque intrinsèquement liée à la qualité perceptive. C'est dans un mouvement de pensée analogue que se retrouve plus tard, dans "Constructions dans l'analyse" (1937), la place majeure accordée aux relations affectives dans le travail'analytique, "matière première" qui se saisit dans le transfert, répétition, représentations d'expériences primordiales, à l'origine des constructions psychiques. Le même souci est présent, quant à la réalité (ou à l'existence) de la perception et des relations affectives : il s'agit chaque fois, en effet, de chercher une adéquation minimale entre ce qui se construit, ou se figure, et une réalité sans cesse modifiée, biaisée, travestie par les nécessités, les aléas et les contraintes de l'expérience et du travail psychique.
Il'arrive cependant que les indices des "affects appartenant au refoulé" ne se répètent pas, parce qu'ils ne se représentent pas, comme s'ils n'avaient pu trouver une inscription minimale. Ils relèvent peut-être du processus d'inachèvement que D.W. Winnicott (1974) analyse dans "La crainte de l'effondrement" : celle-ci concerne des expériences qui n'ont pu être véritablement intégrées psychiquement, parce que leur puissance d'effraction était telle que celles-ci se sont révélées impossibles à accueillir à l'intérieur du moi. Winnicott insiste : l'effondrement a déjà eu lieu, et la crainte qu'il n'advienne renvoie, en fait, à un événement psychique déjà passé, mais toujours maintenu sous forme d'une menace externe. Ces expériences inadmissibles ont toujours à voir, précise Winnicott, avec des défaillances de l'environnement, défaillances sans doute perçues mais non reconnues du fait sans doute de l'excès de douleur qu'elles déterminent. En ce sens, la crainte de l'effondrement constitue une référence extrêmement intéressante dans l'élaboration de la représentation. Si, en effet, un objet doit avoir été perdu pour pouvoir être représenté, s'il doit avoir apporté une satisfaction minimale, il faut aussi et avant tout que, au-delà de la perception de sa perte et des aléas de ses défaillances, l'éprouvé de cette perception puise être accueilli et reconnu comme tel. Lorsque cette perception intérieure n'est pas réalisable, alors la crainte de l'effondrement devient envahissante et dévoile la nature "psychotique" – dit Winnicott – de l'angoisse, dont la caractéristique majeure est que, justement, elle ne trouve pas de forme représentative susceptible de la contenir.
Parmi les contradictions les plus troublantes de la clinique des troubles à l'adolescence, celle qui oppose et associe la lutte contre la passivité et l'extrême dépendance constitue une énigme majeure. C'est par la voie de l'excitation qu'elle peut être approchée, si l'on admet sa situation privilégiée et ambiguë ordonnant la dialectique des échanges entre dedans et dehors. Ce qui est d'abord excité, explique Freud (1905), ce sont les surfaces sensibles, c'est-à-dire la peau et les organes des sens : l'excitation dépend de l'intensité des stimulations externes, mais surtout, l'excitation sexuelle surgit comme effet secondaire dans un grand nombre de processus internes. Les pulsions dérivent directement de ces sources intérieures : elles s'associent et se rassemblent à partir de ces sources et des zones érogènes.
À l'origine de l'excitation, les mouvements pulsionnels sont appréhendables dans deux dimensions, en apparence opposées : passive, du côté de la sensation, de l'empreinte, de la "perception" comme "effet" du stimulus externe ou interne ; active, du côté de la maîtrise, de l'exercice du contrôle. Dans les deux cas, la sensation et le plaisir sont éprouvés de l'intérieur avec, pourtant, une différence d'importance entre les deux : la passivité implique, plus que l'activité, l'engagement de l'objet dans son action sur le sujet. La passivité implique, inéluctablement, le pouvoir de l'objet sur le moi. La lutte contre la passivité, le retournement de la passivité en son contraire (l'activité), parfois dans la démesure (l’hyperactivité), ou encore le contre-investissement de la passivité en activité montrent avec force de quelle manière, dans les conduites compulsives, le refus de l'excitation provoquée par l'autre constitue un objectif majeur, et sans doute – c'est une banalité de le rappeler – à la mesure de l'intensité des désirs et des attentes vis-à-vis de l'objet. À cet égard, J.Mc Dougall (2001) rappelle la signification d'"addiction", du latin "addictus" qui se réfère à une coutume ancienne par laquelle un individu était donné en esclavage. Elle souligne également que l'équivalent français d'addiction, "toxicomanie", est fondé sur le désir de se faire du mal, alors que la terminologie anglo-saxonne souligne surtout l'idée que le sujet "addicté" est l'esclave d'une seule solution pour échapper à la douleur mentale. Ce qui constitue en fait le soubassement essentiel de la dépendance, c'est bien la dimension compulsive aliénante qui soumet le moi à la fois à l'emprise de l'objet et du narcissisme. Dans cette perspective, beaucoup de conduites compulsives relèvent de la dépendance extrême au symptôme qui s'instaure inéluctablement, s'entretient et s'emballe, parce qu'il sert à la fois de masque et de représentant de l'objet. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que les troubles des conduites alimentaires en constituent le paradigme. Le fondement de la compulsion relève de la lutte paradoxale contre la passivité, au sens où je l'ai définie, c'est-à-dire comme "l'être excité par l'autre" – mais un autre qui peut se prendre au filet de la relation spéculaire où l'un est l'autre et l'autre est l'un. Le surinvestissement de la perception s'inscrit alors dans une double valence – narcissique et identificatoire – sous l'égide notamment de la relation mère/enfant et, dans les cas qui nous occupent, de la relation mère/fille.
Si l'on se penche, parallèlement, sur les modalités d'identifications, et plus précisément encore sur les identifications à la mère, on peut se saisir de ce que leur dimension narcissique tend à s'approprier : en affichant une quasi absence de désir sexuel – quel qu'en soit l'objet – les adolescentes qui présentent des graves troubles des conduites alimentaires cherchent à montrer, à incarner même, l'absence de tout désir sexuel chez leur mère. La dynamique narcissique et son aboutissement dans le reflet et le miroir conduisent à une affirmation en double sous-tendue par un déni d'importance : le désir de la fille est abrogé en miroir du refus de perception de celui de la mère. Ce faisant, la nécessité de maintenir à tout prix cette conviction fige tout mouvement et entraîne une immobilité susceptible de rendre compte du caractère parfois inamovible du symptôme. C'est qu’ainsi la fille continue de nier activement la présence du désir de la mère et pas seulement, comme on pourrait le croire d'abord, le sien propre. Le sacrifice du désir du sujet vise en fait, aussi, à en priver la mère.
Pour Gloria, s'arracher les cheveux pouvait aussi constituer le pivot d'un miroir reflétant à la fois le désespoir maternel'et la négation de tout désir libidinal chez elle. Le masochisme apparaît alors sous sa forme la plus drastique – celle du sacrifice – en effet.
La place et la fonction des perceptions dans cette problématique appellent particulièrement l'attention du fait du surinvestissement des surfaces sensibles dans ces pathologies : enveloppes corporelles, images du corps, intensité du visuel, appropriation de l'externe, autant d'investissements périphériques qui tentent d'oblitérer les impératifs des contraintes intérieures. L’illusion est ouverte du côté du contrôle, de la maîtrise, du pouvoir sur les mouvements pulsionnels qui doivent être à tout prix muselés parce qu'ils dénoncent l'existence vivante et troublante d'un monde interne risquant sans cesse de déborder et d'envahir, en mettant à mal les capacités de contenance.
Deux problématiques centrales nous semblent illustrer cette procédure : celle qui relève de la psychosexualité ; celle qui relève, en deçà, de la question de la perte d'objet et de son traitement.
Le refus de la source interne de la pulsion, tel que l'a décrit A. Green (1983), traduit de notre point de vue le refus de la passivité, à entendre comme réaction à l'objet. Accepter la passivité, c'est d'abord admettre que l'action de l'objet a un effet de modification sur le moi du sujet. Le corollaire en est la reconnaissance de ces transformations internes, notamment dans leur traduction la plus perceptible au départ, c'est-à-dire en termes d'intensité, donc quantitativement : l'effet de l'objet se repère dans une augmentation de l'excitation. Les émois déterminés par les premières expériences sexuelles au moment de la puberté sont aussi susceptibles d'être massivement refusés du fait de l'intensité du trouble qu'ils génèrent : lorsque l'adolescent est soumis aux lois de l'excitation sexuelle, il'est confronté à un équivalent "traumatique", puisqu'il'est la proie d'une cause à la fois externe et interne, produit de ce qu'il peut vivre comme une effraction majeure, une séduction massive.
Quand Gloria eut 8 ans, un cousin de l’âge de son frère s'approcha d'elle, de trop près, régulièrement. Gloria me fit part de cet événement plusieurs mois après le début de sa psychothérapie. Sa plainte concernait certes le cousin séducteur, mais surtout sa mère que ne voulut rien voir de ce qui se passait pratiquement sous ses'yeux. Pour Gloria, un premier lien s’établit entre sa passivité, sa soumission aux désirs de son cousin, la passivité de sa mère face à cette situation, et l'apparition de son symptôme. Les cheveux arrachés, cela au moins pouvait se voir, cela au moins ne pourrait pas être dénié : et pourtant, ses actes, au sens plein du terme car cette fois elle agissait sur son corps, sur son propre corps, passèrent tout autant inaperçus. Rien ne fut vu, entendu, rien ne fut entrepris pour tenter de comprendre ce qui se passait pour l'enfant. C'est une mère sans cesse endeuillée et, paradoxalement en apparence, toujours hyperactive, que Gloria évoque. Une femme occupée, jamais vraiment là, toujours soucieuse de ses investissements professionnels, toujours tournée vers le dehors, un ailleurs qui semblait totalement l'absorber.
Dans ce contexte, l'intérêt du grand cousin pour elle prit un autre sens : en vérité, elle me le dit un jour – et cela la soulagea considérablement – il était doux avec elle et elle avait du plaisir dans ces contacts érotiques. Lorsqu'ils prirent fin – elle devait avoir une douzaine d'années – elle crut être débarrassée d'une situation lourde à porter, et pourtant, elle s'arracha les cheveux de plus belle, sans doute mobilisée intérieurement par l'immense peine d'avoir perdu l'attention du jeune homme, d'avoir à renoncer à ce lien incestueux dont la nature œdipienne m'apparut évidente.
Double destin de ces amours infantiles : se condensent en effet là, à la fois l'angoisse de perdre l'amour de l'objet et la perte œdipienne. Aux abords de la puberté et de l'adolescence, Gloria se retrouve désespérément seule, ayant de surcroît dépassé le seuil de durée de vie de son frère, cet éternel'enfant qui, lui, n'eut jamais à décevoir les attentes idéales de ses parents puisque la sexualité génitale ne put jamais l'atteindre. Le renforcement de la symptomatologie de Gloria – très clivé, semble-t-il, ou absent de son fonctionnement psychique – est déterminé, me semble-t-il, par les transformations de la puberté et l'entrée dans l'adolescence. L'éloignement du grand cousin, justement à cette période de la vie, alimenta pour elle l'idée que son corps de femme ne pouvait être regardé, qu'il ne pouvait engendrer du désir et que, par là-même, elle se devait de l'attaquer. Evidemment, le choix des cheveux est très polysémique puisqu'il condense le désespoir et l'érotisme féminin.
Cette position de retournement de la passivité en activité se découvre donc dans la confrontation à la perte d'objet, ou plutôt, pour utiliser la formulation freudienne adéquate, de l'angoisse de perte d'amour de la part de l'objet. On constate alors une superposition voire une équivalence entre l'angoisse de perte d'amour de la part de l'objet et la perte de la perception de l'objet. Cette notation est essentielle pour notre propos : elle montre en effet la fonction du surinvestissement de la perception, non pas seulement pour pallier les défaillances des perceptions internes, mais peut-être même pour les abraser, parce qu'elles sont sources d'excitation et de détresse.
Le surinvestissement du visible et donc du regard est constitutif du narcissisme. L'addiction à "l'être vu" pourrait rendre compte du noyau commun de toutes les problématiques narcissiques dans leur rapport à l'autre : une spécularité qui maintient l'investissement de la surface (au détriment de la profondeur) et protège ainsi de toute forme d'intrusion ; encore que, dans certains cas, l'extrême érotisation du regard bascule dans une quasi projection de la pénétration par l'autre.
Le besoin de percevoir/être perçu est donc central dans le double registre de la relation à l'objet et de la relation à soi. Il s'inscrit dans un mouvement d'identification narcissique qui offre un destin singulier à la problématique de la perte. Comme Freud le souligne dans "Deuil'et mélancolie" (1915), les modalités d'inscription des identifications sont différentes dans les deux affections : dans le deuil, l'identification demeure hystérique, c'est-à-dire qu'elle promeut l'objet du désir de l'autre et conserve la part libidinale de l'amour d'objet en dépit du parcours douloureux du travail d'élaboration de la perte. L’identification, qui offre l'un des moyens les plus puissants dans le traitement des problématiques de perte, consolide le lien à un objet conçu, représenté en tant que tel, dans le respect de la différence, dès lors qu'elle s'engage dans un mouvement objectal. L’identification narcissique caractériserait davantage le processus d'élaboration de la perte dans ses configurations d'allure mélancolique. L’investissement de l'objet s'avère alors peu résistant et la régression conduit à une identification au même, sans prise en compte de la différence. Le bénéfice de cette opération est que la haine contre l'objet s'exerce désormais contre le moi du sujet ("confondu" en quelque sorte avec lui). Mais ce bénéfice est illusoire car, dans l'identification mélancolique, ce qui prévaut et domine relève du mortifié, du désanimé, dans un retournement autodestructeur particulièrement toxique. Cependant, ce retournement relève, cette fois encore, du renversement en son contraire de la passivité : une lecture attentive de "Deuil'et mélancolie" et de "Le moi et le ça" met en évidence le fait que, dans le traitement mélancolique de la perte, l'objet n'est pas "perdu" mais "abandonné" (C. Chabert, 2003). C'est-à-dire que, cette fois encore, le sujet occupe une position active de désinvestissement apparent ou de refus, plutôt que de se soumettre à une perte qui s'impose à lui et qui l'affecte.
En résumé, dans ce bref survol des axes de problématiques à l’œuvre à l'adolescence, je souhaite souligner que dans la double perspective de la sexualité et de la perte, c'est un destin pulsionnel narcissique qui prévaut, certes – et cela est admis par tous les auteurs – mais au-delà ou en deçà, l'enjeu essentiel relève d'une part du retournement impératif de la passivité en activité, et d'autre part de la mobilisation impérative de ce retournement, seule solution pour parer au danger de reconnaissance de la déception et de la perte.
Dès les premiers mois de sa psychothérapie, Gloria cessa de s'arracher les cheveux. Au bout d'un an, elle abandonna foulards et turbans et put montrer sa tête à découvert.
À mon avis, deux éléments essentiels sont susceptibles d'être évoqués dans le processus thérapeutique. Le premier relève, bien sûr, de l'écoute des perceptions internes dans le mouvement même du transfert. Gloria, tout en montrant les signes extérieurs les plus éloquents, visuellement, de son désespoir, ne pouvait véritablement les admettre. Identifée à l'attitude de détournement qu'elle prêtait à sa mère, elle s’était massivement engouffrée dans un surinvestissement actif de l'extériorité qui tendait à nier ce qu'elle pouvait éprouver à l'intérieur : le chagrin, la peine, le désespoir certes, liés à la conviction de n'avoir pu, su, consoler sa mère de la disparition du fils tant aimé. Mais aussi la haine engendrée par cette déception narcissique, l'ambivalence impossible à reconnaître sa crainte concomitante d'être abandonnée encore davantage. Chez elle, le paradoxe était particulièrement frappant : tout en dénonçant la faillite de son environnement familial, tout en accusant ses parents et surtout sa mère d'indifférence à son égard, elle ne pouvait se résoudre à vivre ailleurs car se maintenait, clivée en elle, la conviction tout aussi tenace qu'elle leur était indispensable, que sans elle leur univers déjà précaire s'effondrerait et qu'elle n'avait donc pas le droit de s'engager dans sa vie à elle, une vie qui lui appartiendrait en propre.
Ce faisant, c'est à l'enfant mort qu’une part de ses identifications s'engageait, un enfant qui, par définition, s'inscrit dans le paradoxe de n’être plus l'et en même temps toujours là. J'ai évoqué ailleurs cet enfant mort et sa fonction ultime : celle de figurer un fantasme morbide de passivité totale, d'une extinction pulsionnelle radicale, condensée avec celle d'une innocence tragique. Cette image rassemble des représentations multiples, qu'il s'agisse de l'enfant monstrueux voué à la monstruosité ou à la mort, du frère rival'engendrant des souhaits meurtriers, ou encore du double narcissique, répondant aux exigences de l'idéalité infantile, à l'instar de "His majesty the baby". Lorsqu'il'apparaît comme "enfant mort", ne se prête-t-il pas encore davantage à une idéalisation forcenée, fixée par l'intemporalité, objet d'une paradoxale passion parce qu'il'est perdu ?
Au-delà cependant, les mouvements d'identification touchaient tout autant chez Gloria le domaine de la sexualité : être née fille pour remplacer un garçon mort, grandir comme une fille, vivante, pour devenir une femme, voilà qui pouvait massivement être refusé. La passivité inhérente aux transformations sexuelles, et à leurs effets – en termes d'excitation et de désir – ne pouvait que se révéler de plus en plus forte et se devait donc d'être combattue. Car ce que Gloria garda longtemps secret, peut-être d'ailleurs par le jeu puissant du refoulement, ce fut l'attachement intense qui la liait à son père. Attachement impossible à laisser paraître aux yeux de la mère, pour la peur de la rivalité et de la haine qu'il pouvait déterminer chez elle, attachement impossible à reconnaître pour le fondement à la fois étayant et œdipien qui le cimentait. Le même mouvement qui a conduit Gloria à rencontrer une analyste – un déplacement, un transfert – a permis que se découvre le place essentielle de son père dans la construction de son histoire. Essentielle dans les identifications narcissiques qui les soudaient : un père aussi silencieux et souffrant que sa fille ; essentielle aussi quand elle put découvrir, accepter, construire que l'amour de son père lui revenait à part entière, c'est-à-dire qu'il ne concernait pas seulement l'enfant – l'enfant garçon, l'enfant perdu, l'enfant neutre dans sa bisexualité – mais qu'il concernait tout autant, et peut-être davantage encore, la fille qu'elle était, la petite fille qui, dans sa différence, permettait de croire que, elle au moins, resterait vivante.
Références
Chabert C. (2000) "Les surprises du masochisme moral", Libres cahiers pour la psychanalyse "L'esprit de survie", In Press, numéro 1, pp 107-118.
Chabert C. (2003) "Perdre ou abandonner?", in Le travail psychanalytique, sous la direction de A. Green, Paris, PUF, 198-194.
Chabert C. (2003) "Les voies intérieures", in Féminin mélancolique, Paris, PUF, "Petite bibliothèque de psychanalyse", p. 21-90.
Freud S. 1895, La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979
Freud S. (1905). Trois essais sur la théorie sexuelle, tr. fr., Paris, Gallimard, 1987.
Freud S. (1915). "Deuil'et mélancolie", in Métapsychologie, Œuvres complètes, t. XIII, Paris, PUF, 1988, p 259-278.
Freud S. (1924) "Le problème économique du masochisme", in Œuvres complètes, t. XVII, Paris, PUF, 1992, p. 9-25.
Freud S. (1925). "La négation", in Œuvres complètes, t. XVII, Paris, PUF, 1992, p 165-173.
Freud S. (1937). "Constructions dans l'analyse" in Résultats, idées, problèmes, t. II Paris, PUF, 1985, p. 269-283.
Green A. (1980) "La mère morte", in Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Ed. de minuit, "Critique", 1983, p. 222-253.
Green A. (1984) La pulsion de mort, Paris, PUF
Mc Dougall J. (2001). "L'économie psychique de l'addiction", in Mc Dougall, Marinov, Brelet-Foulard, Lanouzière et al. Anorexie, addictions et fragilités narcissiques, Paris, PUF, "Petite bibliothèque de psychanalyse".
Winnicott D.W. (1974). "La crainte de l'effondrement", Nouvelle Revue de psychanalyse, "Figures du vide", n° 11, 1975, p. 35-44. Nouvelle traduction, in La crainte de l'effondrement et autres situations cliniques, Paris, Gallimard, 2000.
(Brésil, Mai 2005)
1 C'est moi qui souligne.

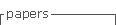









 How to cite this paper
How to cite this paper