Services
An. 1 Simp. Internacional do Adolescente May. 2005
L'oubli du père à l'adolescence
Catherine Chabert
Revenir vers le père: cette proposition qui aurait pu paraître d'un classicisme psychanalytique évident, à une époque presque lointaine, prend l'allure d'une provocation aujourd'hui, car qui pourrait sincèrement prétendre que l'oubli nous a gagnés, quant au père, du seul fait que le penchant vers la mère occupe le devant de la scène?
Un constat, pourtant: depuis plusieurs années, un nombre considérable de travaux cliniques, psychopathologiques et psychanalytiques sont essentiellement focalisés sur la place de la mère et sur ses effets, non seulement dans les perspectives psychogénétiques et développementales dont on connaît les dérives potentielles, mais aussi dans celles qui tiennent la réalité psychique comme primordiale dans l'actualité du transfert.
Certes, il ne s'agit pas pour moi de nier la part fondamentale accordée à la mère au sein du fonctionnement psychique et bien sûr dans la cure; mais je m'inquiète parfois de courants qui tendraient à remplacer le père, pivot essentiel mais non exclusif de l'édifice freudien –je dis non exclusif car combien de notations, combien d'incidentes saisissantes, combien de textes sont là qui attestent de la place formidable de la mère non seulement comme objet d'investissement majeur mais aussi comme paradigme de la dynamique psychique et de son économie– je m'inquiète donc de la "disparition" du père dans l'horizon analytique.
En fait, et c'est sans doute ce qui se dessinera au travers de mon propos, il me paraît –et je pense que nous sommes très nombreux à défendre cette position– que la référence au père et à la mère dans les multiples configurations qu'ils sont susceptibles de prendre comme images, comme figures, comme partenaires de scénarios pluriels des fantasmes originaires, que cette référence donc au père et à la mère (et j'insiste sur le "et" dont je crains parfois qu'il soit remplacé par le "o") est absolument indispensable à conserver.
Dans cette perspective, la référence au complexe d'Œdipe –qu'il soit structurant ou non– nous permet d'aborder la clinique de l'adolescence en tenant compte et du père et de la mère, dans la mesure où ils mobilisent des mouvements contradictoires d'une part du côté des relations d'objet et d'autre part du côté des identifications et de la construction du moi.
Une autre dimension me paraît importante à souligner, même succinctement. La tendance est forte qui consiste à considérer le complexe d'Œdipe comme caractéristique des névroses, et à penser d'autres modalités de fonctionnements psychiques en termes exclusivement pré-œdipiens. Peut-on vraiment considérer que l'accès à l'œdipe soit réservé à certains et pas à d'autres? Ou bien peut-on raisonnablement penser que, comme l'écrit Freud, "chaque nouvel arrivant dans le monde humain est mis en devoir" d'en venir à bout? Dans cette perspective, ce sont les modes d'organisation et d'élaboration du complexe d'Œdipe, ses voies de résolution aussi, qui marqueront sa spécificité et ses différences: nous devrions alors admettre que les formes œdipiennes sont variables et singulières, qu'elles n'obéissent donc pas à un prototype.
Enfin, pour achever ce préambule, je souhaite aborder un autre élément, corollaire des précédents: la clinique psychanalytique a vu s'élargir les limites de ses indications, on le sait. C'est aussi au nom de cette ouverture que certains abandonnent, dans ces cas, la référence à l'œdipe en considérant que l'essentiel de la maladie psychique relève de graves difficultés dans les capacités d'élaboration de l'angoisse de perte, auxquelles les obstacles narcissiques sont généralement associés. Ce constat clinique n'a pas à être démenti. La question que je soulève l'intègre en quelque sorte et je vais essayer de la formuler le plus clairement possible puisque la suite de mon propos s'attachera essentiellement à en analyser les développements et les avatars: à parler de narcissisme et d'angoisses dépressives, doit-on pour autant oublier l'appartenance de l'un et de l'autre au champ de la psychosexualité? Devons-nous établir une ligne de démarcation effective entre ce qui relève des investissements narcissiques et ce qui engage les investissements objectaux? Ne peut-on penser une dialectique qui, pour chacun, suit des mouvements contradictoires, mais aussi complémentaires?
*
Katia a 23 ans, lorsqu'elle vient me voir. Elle n'est plus une adolescente mais, comme Gloria, elle ne se considère pas comme une femme adulte. C'est une grande jeune fille, mince et délicate, qui semble s'efforcer de cacher tout ce qui pourrait constituer l'indice le plus minime de la séduction. Un visage émacié, une coiffure sévère, de grosses lunettes masquant la beauté de ses yeux et une apparence androgyne, voilà les premiers souvenirs que je garde d'elle. Depuis dix ans, depuis sa puberté mais aussi depuis la séparation de ses parents, elle passe des heures à scruter dans son miroir les signes les plus imperceptibles des imperfections de sa peau. Elle ne supporte pas la moindre aspérité, elle traque millimètre par millimètre tout ce qui, au regard ou au toucher, pourrait altérer un visage qui doit rester totalement lisse et sans défaut. Dois-je préciser que ces signes ont toujours été invisibles pour moi et que, en dépit de ma myopie, je crois qu'en effet ils étaient très peu apparents, sans doute grâce à l'art de les camoufler auquel Katia excelle. Chaque matin, chaque soir, elle part à la chasse de ces marques. Elle les attaque, elle veut les détruire, mais le résultat est là, chaque jour plus désespérant: non seulement ces signes régénèrent, mais son acharnement compulsif à les faire disparaître laisse des traces qu'elle tente d'effacer à tout prix. Ses consultations en dermatologie et en endocrinologie se sont multipliées sans résultats. Et pour cause… ce qui commence à l'inquiéter et motive sa venue est un nouveau symptôme apparu il y a un an ou deux. Elle passe beaucoup de temps, chaque matin, de plus en plus de temps, à organiser ce qu'elle appelle son "planning". Il faudrait que chaque instant de sa journée entre clairement dans une case horaire définie. Le temps pris à la fabrication de son emploi du temps augmente sans cesse, ce qui l'oblige à recommencer indéfiniment pour tenir compte des retards accumulés. Même scénario, même rituel que pour sa peau. "Ma peau, mon temps, dit-elle, c'est l'enfer de ma vie". Elle ne pense qu'à ça. Sauf que, quand même, elle s'inquiète de la misère de sa vie amoureuse et s'affole de son avenir professionnel.
C'est au hasard d'une énième consultation de dermatologie que l'idée lui est venue d'aller voir une psychanalyste. Sans conviction et sans espoir, ajoute-t-elle aussitôt, et pourtant la voilà qui parle, volubile, avide de dire, déversant un flot de paroles et de larmes comme si, tout à coup, une simple présence attentive faisait sauter les verrous de sa prison.
Pendant de longs mois, Katia s'active et s'efforce de me montrer que personne, ni elle bien sûr, ni moi évidemment, ne parviendra à la dégager de ses compulsions. Pour elle, aucun changement ne peut advenir. Elle proclame sans cesse son indépendance et la force de ses déclarations est à la mesure de sa position interne qui, de mon point de vue, maintient une dépendance extrême vis-à-vis de ses objets, dépendance dont le soubassement essentiel relève d'une dimension compulsive aliénant qui soumet le moi à l'emprise de l'objet et du narcissisme. Dans cette perspective, on peut considérer que beaucoup de conduites compulsives témoignent de la dépendance au symptôme lui-même, qui s'instaure inéluctablement, s'entretient et s'emballe parce qu'il sert de masque et de représentant de l'objet. Le fondement de la compulsion relève de la lutte paradoxale contre la passivité, au sens où j'ai proposé de la définir à partir de Freud, c'est-à-dire comme "l'être excité par l'autre", mais un autre qui peut se prendre au filet de la relation spéculaire où l'un est l'autre et l'autre est l'un. Ce que je cherche à dire, dans cette brève présentation initiale de la cure de Katia, c'est que nous sommes bien là confrontés à une forme d'impasse narcissique, butée maligne qui marque de son sceau l'engagement transférentiel.
La version de son histoire, par Katia, était péremptoire. Elle en soulignait avec l'humour et la causticité qui la caractérisaient, le caractère banal, presque vulgaire, si commun disait-elle, qu'il en devenait lui-même blessant, car il signait une représentation d'elle-même qu'elle défendait coûte que coûte: elle était quelconque, affirmait-elle. Elle était moyenne, médiocre et sans intérêt, alors qu'elle aurait souhaité par dessus tout être quelqu'un.
Une histoire banale donc: ses parents ne s'étaient jamais aimés ou plutôt non, son père n'avait jamais aimé sa mère. Il avait accepté de l'épouser à cause d'elle, Katia, une enfant dans le dos! Le couple avait mal tenu pendant treize ans –Katia évacuait littéralement la naissance des deux enfants venus après elle– puis avait décidé de se séparer. La mère en était toujours meurtrie, sa haine contre son mari n'avait jamais désarmé et s'aggravait du fait de sa solitude. Le père, quant à lui, était un monstre d'égoïsme et de cruauté inconsciente et chaque fois qu'elle parlait de lui, la voix de Katia montait de plusieurs tons. Pas de mots assez forts pour dire son mépris pour lui, la honte d'être sa fille, l'horreur qu'elle éprouvait chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Et pourtant, elle était la seule de toute la famille à continuer à le rencontrer. Bref, la figure du père, objet de toute sa rage et de son affliction, occupait une grande place sur la scène de son théâtre intérieur. Et je lui dis un jour qu'elle avait le même acharnement à l'accabler afin de le faire disparaître de ses pensées que celui avec lequel elle torturait son visage. Je pensais, ce faisant, que c'était là une véritable entreprise de défiguration qui visait, en effet, davantage le père (et sans doute la mère), mais dont elle se déclarait la première victime.
La mère, en contraste, provoquait chez elle une soumission et une obéissance alarmantes. Katia guettait chez elle –elle la scrutait, elle aussi– le moindre signe de tristesse, de désintérêt, d'ennui ou d'irritation, et la perception des états d'humeur de sa mère ordonnait ses propres mouvements de plaisir ou de déplaisir. Pas question de la quitter, d'aller vivre un peu plus loin d'elle. Ce serait répéter l'abandon du père, sa fuite odieuse, sa lâcheté et son égocentrisme détestables. Elle, Katia, se devait de rester là, toujours, indéfectiblement affectée à son poste: une sentinelle, une gardienne du temple, une vestale?
Je pouvais littéralement lui appliquer le propos de Freud dans "Les métamorphoses de la puberté" lorsqu'il invoque la tâche qui incombe aux adolescents –s'affranchir de leur dépendance vis-à-vis des figures parentales– et la difficulté de certains –et surtout de certaines!– à l'accomplir:
"En même temps que ces fantasmes manifestement incestueux sont surmontés et rejetés, s'accomplit une des réalisations psychiques les plus importantes, mais aussi les plus douloureuses de la période pubertaire: l'affranchissement de l'autorité parentale, grâce auquel est créé l'affranchissement entre la nouvelle et l'ancienne génération, si important pour le progrès culturel [; …] Il y a des personnes qui n'ont jamais surmonté l'autorité des parents et ne leur ont pas retiré la tendresse qu'ils leur vouaient, sinon de manière très imparfaite. Il s'agit pour la plupart de filles qui, à la joie de leurs parents, persistent bien au-delà de la puberté ans un amour filial absolu [; …] On apprend par là que l'amour apparemment non sexuel pour les parents et l'amour sexuel s'alimentent aux même sources, ce qui revient à dire que le premier ne correspond qu'à une fixation infantile de la libido"(p 171).
J'aurais pu entièrement interpréter la répartition des investissements de Katia dans la perspective d'une fixation narcissique à la mère, aux effets d'une confrontation à une figure maternelle déprimée, défaillante, insuffisante à satisfaire les besoins d'étayage de son enfant. Evidemment, je ne néglige pas cet aspect dont je pense qu'il est, de toutes façons, régulièrement présent et actif: ne pas le reconnaître serait contraire à la conception psychanalytique de la construction des identifications et, là-dessus, je reviendrai un peu plus tard.
Mais je cherche à souligner que l'exclusion du tiers, du père, de la compréhension théorique et clinique de telles situations relève, à mon avis, d'un piège transférentiel: celui qui pousserait Katia (et d'autres bien sûr) à démontrer qu'à l'instar de son attachement indéfectible et totalitaire à sa mère, personne, en dehors de son analyste – et encore fallait-il que le déplacement ait eu lieu– ne comptait désormais pour elle.
Katia avait passionnément aimé un garçon de son âge rencontré en Terminale. Passionnément, sans jamais lui montrer le plus petit signe d'attraction, voire même en évitant systématiquement tout risque d'intimité entre eux, alors qu'elle était convaincue de la réciprocité de leur attirance. Elle considérait que le jeune homme était aussi timide et idéaliste qu'elle, elle se berçait d'attente et de rêves jusqu'au jour où finalement il tomba dans les bras d'une autre. C'est très précisément à ce moment là que les programmations d'emploi du temps se mirent frénétiquement en place. La douleur de cette déception restait intacte. Depuis, Katia partageait sa vie amoureuse entre de brèves liaisons avec des hommes qu'elle méprisait et de longues aventures virtuelles sur Internet.
À cet égard, on pourrait tout à fait entendre la vie amoureuse de Katia sur le modèle d' "Un type particulier de choix d'objet chez l'homme" développé par Freud en 1910 et dans lequel apparaît pour la première fois le "complexe d'Œdipe". Le rabaissement des hommes nourrissait une bonne part des propos de Katia. Ils étaient indélicats, brutaux, mais aussi plutôt niais, grossiers, peu intelligents et elle prenait un vif plaisir à ces portraits qu'elle dessinait dans une langue intransigeante, incisive, acérée, mêlant toujours la rage et les larmes dans une sorte de plainte infinie infiltrée de revendications blessantes et sans cesse entretenues. En même temps, elle maintenait enfouie au plus profond d'elle-même, comme un trésor jalousement gardé, une figure de père à la fois idéale et excitante, à laquelle elle restait fondamentalement attachée.
Avec moi, l'enjeu était double: dans ses difficultés à admettre une liaison féconde entre nous deux, elle préservait et son lien à sa mère et son lien à son père puisque, justement, son analyse ne lui permettait en aucune manière de rencontrer un autre homme. Le problème, pour Katia, était que, à son avis, dans la réalité, son père et sa mère, tout en étant séparés, restaient effectivement seuls et que, dans cette situation, Katia pouvait se penser comme l'objet d'amour privilégié de l'un et de l'autre, et donc coupable de les avoir séparés, d'autant plus coupable qu'inconsciemment elle réalisait pleinement ses désirs œdipiens; même si, bien entendu, cette représentation était cachée derrière une autre, inversée, et qui était portée par les reproches qu'elle se faisait de les avoir contraints à se marier du fait de sa conception..
C'est au cours de cette période, bien difficile, où elle réagissait très négativement à ses réussites –elle venait d'être reçue major de son école et avait été très "remarquée" pour la qualité exceptionnelle de ses travaux– qu'elle vint un jour, complètement bouleversée. Jusqu'ici, elle s'était toujours plainte de la distance de son père, de son manque d'intérêt pour ses enfants, de son avarice, de son caractère obsessionnel… bref, je l'ai déjà évoqué, ce père n'avait aucune grâce à ses yeux. Elle arrive donc ce jour là, fébrile et tempétueuse: elle vient de découvrir une photo que son père avait fait d'elle, enfant (elle devait avoir quatre ou cinq ans). Sur la photo, elle est debout sur une table, et "prise par en dessous". Tout s'organisait désormais dans sa tête: son père était un pervers, un voyeur et il avait, pour sa fille, une attraction incestueuse. C'était la cause, disait-elle, de tous ses malheurs à elle. Elle avait dû être traumatisée et sans doute qu'elle continuait d'en subir les effets. Sa haine pour son père était évidemment exacerbée par cette trouvaille, mais en même temps, le sens qu'elle donnait à la photo justifiait en quelque sorte après coup l'état d'extrême excitation dans lequel toute évocation de ce père la plongeait. Dans les mois qui suivirent, elle s'acharna de plus belle contre son visage et s'engouffra dans un mouvement d'auto-mortification inquiétant. En même temps, elle déplorait l'échec de son analyse tout en développant une féroce jalousie à l'égard des autres, ces patients qui avaient l'air d'être si heureux de vivre qu'elle me soupçonnait de leur consacrer tous mes soins, le meilleur de moi-même, alors qu'elle se sentait négligée: les autres étaient, avec évidence, beaucoup plus intéressantes. "Intéressantes?", dis-je, à tout hasard. Oui, elle pensait que les autres femmes étaient beaucoup plus intéressantes qu'elle. Elle en voulait pour preuve, l'intérêt de son père pour les autres femmes justement, la séduction qu'il semblait exercer sur elles et la rage dans laquelle cela la plongeait: comment un homme aussi peu agréable, aussi déplaisant, pouvait déployer un tel charme? Les ruminations incessantes qui la tourmentaient à ce sujet étaient une torture: elle ne comprenait pas pourquoi elle s'acharnait à ce point contre elle-même alors que le coupable, c'était lui, ce père indigne et sans valeur qu'elle vouait aux gémonies et dont elle souhaitait violemment être débarrassée.
*
Chez Katia coexistent deux objets d'attaque incessante, son père et elle, pris ensemble à la fois dans une spécularité scellée par des identifications narcissiques évidentes et en même temps dans une conflictualité œdipienne non moins agissante. Dans cette bataille acharnée, la mère reste, en apparence, préservée, sauf que, entre Katia et elle, le réseau narcissique et œdipien est tout autant mobilisé. Par ses états d'humeur dépressive, par sa solitude et son refus du plaisir, Katia colle à l'image de sa mère qu'elle entretient avec passion: en affichant la permanence de son insatisfaction, elle cherche à montrer, à endosser même, l'absence de toute satisfaction chez sa mère. La dynamique narcissique et son aboutissement dans le reflet et le miroir conduisent à une affirmation en double sous-tendue par un déni d'importante: le désir de la fille est abrogé en union au refus de perception de celui de la mère. Cependant, cette dynamique narcissique ne constitue qu'un versant de la problématique. L'autre se décline, avec évidence, en termes œdipiens: nier le désir entre la mère et le père revient à dénier le lien sexuel entre eux, en maintenant l'impossibilité infantile de se représenter la sexualité des parents, en réalisant le souhait infantile de séparation du couple, en se rebellant contre une exclusion menaçante imposée par leur vie amoureuse.
Pour Katia, les efforts incessants pour exclure toute représentation de la scène primitive, le refus d'en admettre l'incidence et donc la force du refoulement qui en assurait l'éloignement se révèlent à la mesure de ses manifestations en apparence les plus étrangères. Ce qui surgit chez elle avec une violence bouleversante pourrait pourtant bien être associé au fantasme: la scène de la photo, scène de séduction s'il en est, où elle n'entend pas ses propres mots –"prise par en dessous"– relève d'un léger déplacement, en apparence, mais d'un déplacement lourd de conséquences. Dans la scène de séduction, au-delà de ses accusations contre la "perversité" de son père, elle occupe une place centrale, condensant le triomphe de l'enfance et de la féminité. Et dans le même temps, c'est à son analyste qu'elle se montre, dévoilant les "dessous" de ses plaintes, et du même coup les annulant puisque c'est comme "bien-aimée" qu'elle se présente à moi désormais. Bien-aimée du père parce qu'elle est sa seule fille, parce qu'elle lui ressemble dans sa combativité et la vitalité de son goût de vivre, bien-aimée parce que, finalement, leur amour mutuel a surmonté l'épreuve de la séparation. Bien-aimée qui doit aussi payer pour ces péchés, pour le plaisir si fort qu'il a dû être effacé, caché au dehors, refoulé au dedans, pour ce plaisir infantile qui doit rester secret.
Etre aimé du surmoi, même au minimum, est la condition pour pouvoir rester vivant car le surmoi assure, par identification et intériorisation, un regard bienveillant pour le moi, à l'instar de celui du père qui interdit parce qu'il aime et protège. Mais il est aussi une formation du moi issue du complexe d'Œdipe, ou au moins consolidée par lui: il relève, comme toute identification, d'une sédimentation à partir de laquelle un double mouvement s'accorde –identification au père et à la mère dans le cadre d'un Œdipe complet. Double identification dans la constitution même du surmoi: l'une qui s'ancre sur l'état d'impuissance et de faiblesse du moi infantile, en quête de protection; l'autre, arrimée au développement de l'Œdipe, réclamant, elle aussi, un interdit préservant de la confusion incestuelle. Ce que, déjà en 1905, Freud appelait "la barrière de l'inceste" reste la condition pour que la part prise à l'autre, l'appropriation du trait par identification, maintienne la dimension vivante de l' "être comme", compromis effectif entre la frustration et la satisfaction du désir –être comme, certes, mais ailleurs, hors du champ originaire du fantasme.
Ainsi, la capacité à renoncer, sans être détruit, peut être considérée comme un produit de la fonction protectrice du surmoi, de son effectivité. Ce destin de la culpabilité met en évidence la part vivante du moi, son empreinte libidinale, indéfectiblement attachée à l'objet, alors que l'orientation mélancolique, elle, l'abandonne et s'engouffre dans la voie narcissique vite enlisée par le parasitage d'un objet introjecté certes, mais désanimé, détruit, mort.
En redécouvrant et en reconnaissant son amour pour son père (à la mesure de sa haine pour lui), Katia en éprouve bien sûr la dimension transgressive, presque criminelle. Mais en même temps, l'amour du père pour elle constitue un formidable étayage, une fois désamorcées les convictions incestueuses: c'est un père à la fois tendre et exigeant, préoccupé de sa fille, étonnamment présent dans la réalité de sa vie, qui se dessine peu à peu. C'est là que le surmoi, tyrannique et sévère auquel Katia s'était masochiquement soumise, trouve une autre source, bienveillante, qui l'autorise enfin à abandonner ses compulsions auto-destructrices. (Une incidente: je ne reprends pas ici la place et les effets du transfert qui pourraient constituer à eux seuls une autre conférence!). Freud a insisté sur les corrélations inconscientes entre l'attachement au père et à la mère, en soulignant notamment que, derrière tout grand amour pour le père, se cache et se découvre un grand amour pour la mère. Peut-on poser la même question à propos de la haine?
Au début du traitement de Katia, j'ai été très vite convaincue du renversement en son contraire de son immense amour pour son père. Son hostilité déclarée, sa fougue, ses rougeurs, ses larmes, allaient vraiment dans le sens d'une extrême ambivalence dont le complexe d'Œdipe proposait une orchestration partielle certes, mais qui n'en permettait pas moins une distribution pulsionnelle sur la mère et le père. C'est cette partition qui se déploie dans le transfert et en permet l'analyse. Je ne crois pas qu'il eût été possible d'aborder et surtout d'interpréter d'emblée l'ambivalence de Katia vis-à-vis de sa mère. C'est forte de l'analyse de son lien à son père –et dont, bien sûr, sa mère n'était pas absente–, forte aussi de son ambivalence à mon égard, qu'elle put vraiment s'y confronter, et d'abord en admettant enfin que sa mère avait été l'objet du désir de son père. À cette mère-là, à cette jeune mère de l'enfance, les voies de l'identification étaient ouvertes et avec elles une possible résolution de la névrose infantile.
(Brésil, Mai 2005)

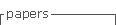









 How to cite this paper
How to cite this paper